Quels sont les facteurs de la pénurie alimentaire dans les pays en voie de développement ?
Quelles sont les répercussions sur la santé
de la population ?
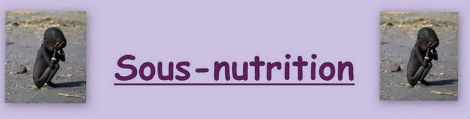
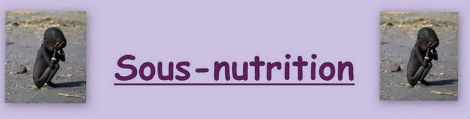
III. Facteurs politiques sur la sous-alimentation
a) Conflits
En effet, en Ethiopie par exemple, dans la région d’Ogaden, la politique refuse de leur donner de l’eau ou de la nourriture car elle considère que les gens de cette région soutiennent la guérilla donc des ennemis. Certains Somalie exterminaient leurs troupeaux et frappaient une population négligée par le gouvernement. Cette famine était couverte médiatiquement donc personne n’exprimait de doutes à son égard ce qui arrangeait le gouvernement.
|
|
Depuis mi-avril 2011, l’armée saisissait les autobus des gares routières afin de transporter les nouvelles recrues formées à Addis Abbeba au front.
De plus certaines informations faisaient états d’achats en grandes quantités d’armements, d’avions Sukhoi, d’hélicoptères ce qui avait épuisé les rares fonds du pays. Le gouvernement éthiopien a lancé un rapport alarmant sur l’approche d’une grave crise alimentaire pour qu’il puisse poursuivre les préparatifs militaires sans se soucier de sa population qui « devait être pris en charge par la communauté internationale ».
C’est le cas dans le triangle de Luwero, au nord de la capitale Kampala d’Ougaden où les autorités ont préféré se préoccuper d’obtenir des armes plutôt que de fertiliser ses terres. Le Daily Monitor, le quotidien ougandais, a écrit « Certains de nos dirigeants ont une vision étroite de la sécurité nationale. Ils pensent que nos vies sont en danger seulement en face d’une menace terroriste, d’activité rebelle ou d’une supposé invasion étrangère. » Il faudrait penser à un meilleur répartition des dépenses publiques.
En effet, il semble que le secteur militaire monopolise le budget de l’Etat au détriment du secteur agricole car cet argent pourrait être utilisé pour « [...] avoir des systèmes d’irrigation fiables, des engrais biologiques, mettre en place des mesures pour limiter les conséquences du changement climatique, améliorer les graines, combattre les nouvelles formes de maladie sur les cultures recenser la population […] », les Ougandais n’auraient pas à faire appel à des interventions extérieures pour se nourrir.
b) Le détournement des dons
Beaucoup de camions sont saisis par le gouvernement éthiopien pour les besoins du front au lieu de les donnés au population en besoin dans le sud éthiopien. De plus, quelques centaines de million de dollars ont été investis dans les avions et les munitions au lieu d’améliorer le réseau routier car on sait que l’administration éthiopienne dispose d’un seul véhicule à Yabello, l’un des centres administratifs du Borana. Mais la plupart des ONG se refuse obstinément à « faire de la politique » et se sont faites complices du gouvernement d’Addis Abbeba refusant, au début de mesurer l’ampleur de la famine et d’envisager les liens entre la guerre et la famine.
|
|
c) Responsables de cette pénurie alimentaire :
Les Nations Unis ont déclaré l’état d’urgence dans la Corne de l’Afrique le 20 Juillet 2011, ce qui a entraîné un débat sur le véritable responsable de cette pénurie alimentaire. D’une part, il est reproché aux pays riches d’avoir attendu la « dernière minute » pour réagir malgré tous les signaux d’alerte lancés par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) dès Mai 2011.
De plus, beaucoup d’investisseurs étrangers ont acheté les rares sols fertiles de la Corne de l’Afrique provoquant l’expulsion de milliers de paysans de leurs terres, diminuant leur capacité à se satisfaire leurs propres besoins alimentaires grâce à leur récolte donc de façon autonome. Ainsi, tandis que le Programme Mondial Alimentaire tente de nourrir des milliers de réfugiés au Soudan, des gouvernements étrangers (Koweït, Émirats arabes unis, Corée…) y achètent des terres pour produire et exporter des aliments pour leurs propres populations.
D’autre part, les gouvernements africains sont accusés d’avoir délibérément provoqué la famine, surtout en Somalie où les miliciens d’al-Shabab tolèrent à peine la présence d’organisations humanitaires. 12 millions de personnes sont menacées en Erythrée, à Djibouti, au Soudan du sud, dans le nord de l’Ougaden et du Kenya et 3,7 millions de personnes sont touchées par la famine ans le sud de la Somalie. D’après le quotidien Daily Monitor si la famine menace le nord d’Ougaden à présent, c’est que la production y a été faible pendant des années. Et cette faiblesse est la conséquence directe des conflits politiques.
En effet, les causes humaines (conflits, déplacements de population, décisions économiques) interviennent de plus en plus souvent dans la sous nutrition, et sont responsables de plus de 35% des urgences alimentaires en 2004, contre seulement 15% en 1992. La situation est aggravée par les subventions agricoles des pays du Nord et les règles inégales du commerce mondial. En effet, les pays du Sud subissent une concurence déloyale des agricultures du Nord : ces pays sont quasiment à l'écart des échanges internationaux.